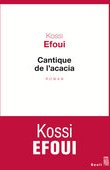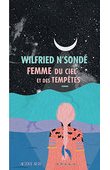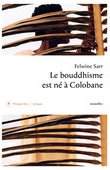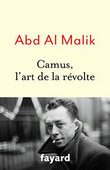Samedi dès 10h, à l’Auditorium
Une journée : Un Monde en relation
8 mai 2018.
Samedi dès 10h, à l’Auditorium
 « Francophonie », un mot exaspérant : tant d’espoirs, tant de désillusions, de malentendus, tant d’occasions manquées ! Mais aussi, tant d’œuvres qui en manifestent la vitalité et font, malgré tout ce qui pèse, de notre histoire commune, l’espace immense d’un dialogue. Cet « espace-monde » : l’utopie concrète d’Étonnants Voyageurs. Dans l’Auditorium, pour ouvrir cette grande thématique, une série de rencontres et de films, qui se prolongeront au fil des trois jours.
« Francophonie », un mot exaspérant : tant d’espoirs, tant de désillusions, de malentendus, tant d’occasions manquées ! Mais aussi, tant d’œuvres qui en manifestent la vitalité et font, malgré tout ce qui pèse, de notre histoire commune, l’espace immense d’un dialogue. Cet « espace-monde » : l’utopie concrète d’Étonnants Voyageurs. Dans l’Auditorium, pour ouvrir cette grande thématique, une série de rencontres et de films, qui se prolongeront au fil des trois jours.
Dépasser les traumas de l’Histoire
Le matin, la projection, en avant-première, d’un film saisissant : Sauvages, au cœur des zoos humains réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor, raconté par Abd al Malik. Pendant plus d’un siècle, de 1810 à 1940, des hommes ont exhibé d’autres hommes en les présentant comme des sauvages dans de véritables zoos humains. Voici le destin de six d’entre eux, à travers des archives exceptionnelles, et les témoignages inédits de leurs descendants. Pour dire l’urgence d’assumer les traumas du passé - pour ouvrir la possibilité d’un avenir.
Suivie à 11h30 d’une rencontre, avec Pascal Blanchard, Jean-Marc Ayrault, Felwine Sarr, Abd al Malik, Wilfried N’Sondé.

Pour poursuivre la réflexion, ne ratez pas la projection exceptionnelle de la série Les Routes de l’esclavage, de Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant, lundi après-midi à l’Auditorium et une rencontre avec Fanny Glissant.
Un imaginaire à construire
Samedi après-midi dès 14h, à l’Auditorium
Y a-t-il des valeurs universelles ?
À 14h : avec Mireille Delmas-Marty, Felwine Sarr, Souleymane Bachir Diagne, Jean-Marie Gustave Le Clézio et Patrick Chamoiseau
Masque de l’impérialisme occidental, disent les uns – et vive donc le relativisme généralisé. Quid alors de la déclaration universelle des droits de l’Homme ? L’Homme : un et multiple, toujours. Un défi d’humanité sans cesse à relever.
France, Afrique, une histoire en partage
À 15h30 : autour de Roland Colin et Souleymane Bachir Diagne. Assumer les traumas de l’histoire pour s’inventer un futur. Quelque chose nous lie, à commencer par le rêve, au nom de valeurs communes, de ceux qui luttèrent pour les indépendances.
Habiter le monde : Édouard GLISSANT, une poétique de la relation
Refaire le monde – autrement dit s’interroger sur les manières de l’habiter – exige, plus que d’agiter à nouveau les moulins à prières des dogmes morts, de comprendre les puissances de l’imaginaire et que c’est par elles que se joue la création des communautés humaines vivantes. La « poétique de la relation » d’Édouard Glissant nous paraît plus que jamais d’actualité. Qui retrouve le sens profond de ce que fut la « rébellion romantique » du XIXe siècle.
Pour lui rendre hommage, un film : Édouard Glissant, un monde en relation de Manthia Diawara : à travers vingt petites vidéos thématiques sur la pensée du grand poète. En dialogue avec Patrick Chamoiseau.
Sam. 16h30, Auditorium
Puis une rencontre : « Repenser notre présence au monde est le défi notre époque, écrit Felwine Sarr, et exige de renouveler les imaginaires de la relation que nous établissons avec nos semblables et avec le vivant ». Avec Anna Moï, Felwine Sarr, Kossi Efoui et Hubert Haddad.
Sam. 17 h 45, Auditorium
Également autour d’Édouard Glissant : Une rencontre avec François Noudelmann qui signe une biographie du grand poète Édouard Glissant : L’identité généreuse (Flammarion).
Dim. 11 h 15, Hôtel de l’Univers
DERNIER OUVRAGE

Romans
Douze palais de mémoire
Le roman fait alterner les monologues d’un père, Khanh, et de sa fille de six ans, Tiên, en fuite sur un bateau de pêche. Ils quittent, pour rejoindre les États-Unis, un pays qui n’est jamais nommé, le Vietnam sans doute. Au fil des chapitres, les voix du père et de la fille, mêlant souvenirs et récit de la traversée, reconstituent l’histoire, petite et grande, qui les a menés là. Deux visions et deux modes d’expression se succèdent : ceux de l’adulte, conscient de la gravité des événements qui les chassent de leur pays, et ceux de la fillette, dont la candeur et la drôlerie apportent une note de poésie au drame de leur situation. Khanh, fils d’un astrologue à la cour de l’ancien régime dynastique, a survécu à une révolution de type communiste grâce à ses compétences d’ingénieur : il a été affecté par le nouveau régime à la construction de ses premiers missiles balistiques. Ces compétences lui viennent de la constitution précoce de douze « palais de mémoire », adaptés de la méthode mnémotechnique antique des loci, qui lui ont permis de devenir un matheux accompli. À l’évocation de ses souvenirs, on comprend que la mère de Tiên, femme de Khanh, est morte dans l’explosion d’un des missiles inventés par Khanh alors qu’elle se trouvait dans une léproserie créée par deux bénévoles américains. Khanh craint que la fillette n’ait été contaminée par la maladie et fuit vers l’Amérique pour pouvoir la soigner. L’apprenant, le capitaine du bateau débarque le père et la fille sur l’épave d’un chalutier échouée sur le rivage. Ils survivent en se nourrissant de mouettes et de coquillages. La vague d’un tsunami les sauve en les emportant vers les côtes thaïlandaises.Le ton du roman est poétique et mélancolique, parfois drôle et parfois doux-amer, mais sans pathos. La grâce chatoyante de certaines descriptions de lieux, de mets, de paysages se mêle à la peinture retenue des émotions et à la délicatesse dans l’énoncé des sentiments. La mémoire est au centre du récit, fragments du passé qui remontent et se heurtent aux détails concrets d’une vie quotidienne chaotique et cependant pleine d’amour
DERNIER OUVRAGE

Romans
Le vent du nord dans les fougères glacées
Seuil - 2022
« Boulianno Nérélé Isiklaire était espécial. Il savait des choses sur le profond du conte, sur la Parole qui demande majuscule, sur la lutte contre la mortalité… Il avait développé une connaissance de tout cela dans le secret de son esprit. »
Le dernier « maître de la Parole » qui, comme les bambous a sept vies et ne fleurit qu’une fois, va s’enfermer dans le silence. Il s’est réfugié dans les hauteurs de l’île, plus haut encore que les mornes où se sont développées les pratiques des veillées. Avant que son retrait ne soit définitif, un groupe espérant qu’il formera l’un des leurs, « le tambour Populo », et, de son côté, une toute jeune fille étrange et solitaire, surnommée « l’anecdote », partent sur ses traces pour qu’il choisisse l’héritier et lui donne en legs sa dernière leçon et le secret de sa poésie. Mais les deux jeunes gens s’associent. Ils vont retrouver, au prix d’innombrables exploits, trois cases successives…
Patrick Chamoiseau renoue donc, au bout de quinze ans, avec sa grande veine narrative riche en personnages inoubliables.
DERNIER OUVRAGE
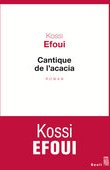
Romans
Cantique de l’acacia
Seuil - 2017
L’enfant n’était pas encore née, mais Io-Anna s’était tatoué son prénom futur dans le bas du dos : Joyce. Et Grace, la belle-mère, devineresse, enchanteresse et guérisseuse, avait été visitée par une vision prometteuse.
"Confiance est le chemin de ce qui échappe au malheur." Cette parole, Io-Anna l’a laissée en dépôt auprès de Grace afin qu’elle soit transmise plus tard à Joyce. Car elle ne sait pas si elle aura le cœur à lui dire, elle-même, ce qu’elle a eu pourtant le cœur à vivre : comment, pour échapper à un ordre patriarcal honni, elle s’est enfuie sur un vélo, à travers la boue des marais, avec Sunday le colporteur qui deviendra plus tard le père de l’enfant ; comment la petite Joyce leur est arrivée, inanimée, sur un radeau flottant. "Il faut se mettre à trois pour faire un enfant, dit Grace, le mâle, la femelle et l’Invisible."
Au pied de l’acacia, l’arbre de l’innocence, un magnifique hymne au courage de vivre, porté par trois générations de femmes en révolte dans l’Afrique d’aujourd’hui.
Revue de presse
- "Un conte animiste et poétique sur le destin. Un récit à la fois réaliste et dystopique qui, dans une écriture faite d’allers-retours, de silences et d’échos, s’entremêle à l’Histoire." (Séverine Kodjo-Grandvaux, Le Monde)
- "Ouvrir un livre de Kossi Efoui, c’est partir à l’aventure : plongé dans un décor théâtral, hypnotisé par le narrateur, le lecteur ne sait plus quel étonnant chemin il a emprunté pour se retrouver à questionner l’Histoire et l’ordre du monde." (Le Monde des Livres)
DERNIER OUVRAGE

Romans
Chanson bretonne
Gallimard - 2020
Ce livre évoque des souvenirs de séjours réguliers que Le Clézio a passés dans la ville de Sainte Marine, à l’embouchure du fleuve Odet, dans le Finistère, lors de son enfance entre 1948 et 1954. Bien que l’auteur se défende de respecter une chronologie, le texte poursuit néanmoins l’ordre de la mémoire, allant de l’enfance vers la maturité. Le lieu de Sainte Marine est placé sous le signe de la mère. La Bretagne, et particulièrement le pays bigouden, que Simone Le Clézio aimait par dessus tout, ce pays où elle a reçu la demande en mariage de son père, ou elle a accouché de son frère et où elle est revenue se réfugier trois mois après la naissance de l’auteur à Nice, à cause de la seconde guerre mondiale. Au fil des chapitres, qui sont présentés comme des « chansons », le narrateur fait revivre une époque où Sainte Marine n’avait pas encore été arraisonnée par les boutiques, les carrefours giratoires, ni les bistrots en tout genre… À travers ces « chansons », l’auteur propose un vrai récit sur son enfance en Bretagne, qui s’enrichit également d’une réflexion plus large sur les changements de la géographie bretonne. Malgré son dépit face à ces bouleversements, Le Clézio ne cultive pas le goût de la nostalgie, car pour l’auteur « la nostalgie n’est pas un sentiment honorable ». Son intention est plutôt de rendre compte de la magie ancienne dont il fut le témoin, par les mots empruntés à la langue bretonne et les motifs d’une nature magnifique. Le texte est bercé par une douceur pastorale, qui fait vibrer les images des moissons en été, la chaleur des fêtes de nuit à Sainte Marine ou la beauté simple d’un verger en fleur – autant une ode à la campagne éternelle que la réminiscence de souvenirs intimes.
DERNIER OUVRAGE
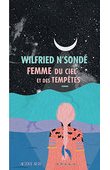
Romans
Femme du ciel et des tempêtes
Actes Sud - 2021
Un chaman de Sibérie trouve sous le permafrost la sépulture d’une reine datant de plus de dix mille ans. Stupéfaction : le corps momifié par les glaces a la peau noire. Décidé à utiliser sa découverte pour protéger un territoire menacé par l’exploitation gazière, le chaman contacte un ami scientifique français dans l’espoir qu’il mobilisera les écologistes du monde entier. Celui-ci monte une discrète expédition avec une docteure germano-japonaise et un ethnologue congolais. Deux mafieux qui tiennent à leurs projets industriels les attendent de pied ferme...
On retrouve l’enthousiasme de Wilfried N’Sondé dans un roman d’aventures haletant qui parle d’écologie, d’harmonie avec le vivant, de partage entre les peuples et de communication entre mondes visible et invisible.
DERNIER OUVRAGE
Revue
Apulée n° 9 - Art et politique
Zulma - 2024
L’art n’a-t-il pas toujours été politique en soi, qu’il l’affiche ou s’en défende ? Telle est la ligne de front d’Apulée #9, qui s’engage depuis le premier numéro dans les brèches et par-delà toutes les frontières de ce début de XXIe siècle.
De l’architecture comme métaphore du pouvoir à la reconnaissance poli- tique des peuples sans État via leur culture et patrimoine artistiques (les Inuit, les Tsiganes, les Berbères et autres nomades du sens), du pillage ou de la destruction en temps de guerre et de colonisation (de l’Acropole d’Athènes à Palmyre, en passant par l’Afrique) à l’universalisme de l’altérité, ce nouvel opus d’Apulée assume toutes les fulgurations et parie sur la voix et les gestes éminemment engagés d’artistes, écrivains, poètes et intellectuels qui portent, encore et toujours, l’idée de liberté, par-delà les identités fracassées sous les chocs de l’Histoire…
Chaudron des allégories et des résistances, critique inventive des mœurs, lien social, pratiques et voix émancipatrices et subversives, utopie en actes : ce nouvel opus s’attache cette fois encore à l’Humain – sans œuvres ni parole confisquées, à l’opposé de la « société du spectacle » – contre la pulsion de mort commune à toutes les politiques du pire. Et comme Apulée l’a toujours défendu !
DERNIER OUVRAGE
Essais
La toison d’or de la liberté
Présence africaine - 2018
Le temps qui vient fera de l’Afrique un protagoniste de premier rang par son poids démographique, ses richesses naturelles, ses espaces sociaux et culturels, et l’on peine aujourd’hui à saisir cette présence africaine dans le monde, brouillée par les guerres, les génocides, les flux migratoires, les conflits politiques. Nous avons cependant une grande histoire commune : la colonisation et la mutation qui a conduit à la libération des peuples en quête de démocratie et de développement. Il est plus que jamais nécessaire d’entendre la parole des acteurs témoins de cette longue et fascinante histoire qui habite notre présent et interpelle notre futur.
Roland Colin est l’un de ces témoins qui, à travers le récit d’un parcours d’exception, nous convie au partage d ‘expériences qui touchent au plus vif nos problèmes du présent. Sensible dès sa jeunesse bretonne à la rencontre des cultures, il s’engage dans la découverte des humanités africaines à l’écoute de son maître Léopold Senghor et s’implique dans la grande aventure de la décolonisation, cette conquête de la liberté, précieuse « Toison d’or » qui doit affronter vents et marées. Il nous montre à quel point la grande transformation africaine, où tout est à imaginer, à construire, à défendre, s’apparente en profondeur à la mutation à l’œuvre dans les peuples de la vielle Europe en quête de nouvelles gouvernances, de nouvelles démocraties. La participation, le métissage des cultures, la greffe entre le monde des racines et l’effervescence des développements créatifs, sont au cœur de ces étapes que l’auteur nous rapporte dans le langage littéraire d’un conteur soucieux de coller au réel. Et l’on voit se dresser ainsi la stature de quelques-uns de ces « passeurs de frontières », à travers des épreuves, des drames, et aussi d’éclatantes démonstrations d’humanité, dans ces terres à la fois proches et lointaines qui se nomment Algérie, Sénégal, Mali, Niger, Madagascar, Rwanda, Tchad, Guinée-Bissau et quelques autres, à l’épreuve des libertés nouvelles. Le maître-mot est alors l’éducation inscrite au cœur de la vie, ce que les conquérants modernes de la « Toison d’or » de la liberté nomment « l’Animation ».
Souleymane Bachir Diagne, le grand philosophe sénégalais, professeur à l’Université Columbia, dans une préface sensible, campe l’auteur comme un « traducteur » entre langues, cultures, sociétés : une fonction répondant à l’exigence des temps présents.
DERNIER OUVRAGE

Essais
Olympisme, une histoire du monde. Des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
La Martinière - 2024
Cet ouvrage de référence sur les 30 Jeux Olympiques d’été, de 1896 à 2024, rend hommage aux athlètes à travers plus de mille images exceptionnelles. Une soixantaine de spécialistes, français et internationaux, offrent en parallèle un panorama complet de chacune des olympiades et proposent une « histoire-monde » résolument transnationale de l’olympisme moderne. Au cours de ces 130 années de Jeux Olympiques se dessinent les grandes mutations de nos sociétés et leurs enjeux politiques, économiques et culturels.
Ce catalogue de l’exposition présentée au Palais de la Porte Dorée d’avril à septembre 2024 retrace la construction des États-nations, l’émergence de la culture de masse, l’entre-deux-guerres marqué par l’opposition entre totalitarisme et démocratie, la Guerre froide, les vagues de décolonisation ou encore les revendications des minorités et des pays émergents. Il évoque aussi la mondialisation économique et le gigantisme des Jeux Olympiques d’aujourd’hui, la reconnaissance du paralympisme, sans oublier d’aborder les questions éthiques et sociétales qui traversent le mouvement olympique en ce XXIème siècle.
DERNIER OUVRAGE
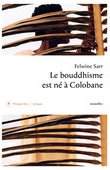
Nouvelles
Le bouddhisme est né à Colobane
Philippe Rey - 2024
Un homme intrigué par l’épuisement de son désir ; une amie disparue, qui, des décennies plus tard, libère son ancien amant de son attente ; une femme écartelée entre les élans du cœur et la raison familiale ; un musicien décédé brutalement dont l’absence rappelle à ceux qui l’ont chéri sa présence en eux ; un sage assis sur un banc pensant l’amour comme la « forge d’oubli du réel ».
Dans cette quête impossible d’un désir absolu et sans limites, les compositions musicales de Toumani Diabaté, Wasis Diop ou bien encore Cheikh Lô accompagnent Fodé, Teibashin et les autres personnages. La musique souligne alors l’amour et le manque, la passion dévorante qui ronge les hommes mais aussi les anime. Le bouddhisme est né à Colobane est une ode à la vie, un appel à « participer du mouvement, y consentir, se laisser traverser et métamorphoser… ».
De Dakar à Abidjan, de Nantes à Kaolack Ndangane, Felwine Sarr compose une partition singulière et vive, une ballade à l’intérieur des âmes humaines pour dire la vie et son inéluctable achèvement, l’amour et ses nuances. Dans une langue limpide, il enjoint aux hommes de se couler dans les rythmes et les sons de leur existence pour faire face à l’urgence
de vivre et d’aimer.
DERNIER OUVRAGE

Essais
De langue à langue : L’hospitalité de la traduction
Albin Michel - 2022
Fort de sa triple culture – africaine, française et américaine –, Souleymane Bachir Diagne s’interroge sur la traduction dans ce texte engagé et humaniste, porteur d’une éthique.
Si la traduction manifeste le plus souvent une relation de profonde inégalité entre langues dominantes et langues dominées, elle peut aussi être source de dialogue, d’échanges, de métissage, y compris dans des situations d’asymétrie, propres notamment à l’espace colonial, où l’interprète, de simple auxiliaire, devient un véritable médiateur culturel.
Faire l’éloge de la traduction, « la langue des langues », c’est célébrer le pluriel de celles-ci et leur égalité ; car traduire, c’est donner dans une langue hospitalité à ce qui a été pensé dans une autre, c’est créer de la réciprocité, de la rencontre, c’est faire humanité ensemble, c’est en quelque sorte imaginer une Babel heureuse.
- « La question de la traduction, de l’universel et du pluriel, est au coeur de l’oeuvre de Souleymane Bachir Diagne, l’une des voix africaines contemporaines les plus respectées. Il a notamment publié, chez Albin Michel, En quête d’Afrique(s) : universalisme et pensée décoloniale, coécrit avec Jean-Loup Amselle (2018) Si la traduction manifeste le plus souvent une relation de profonde inégalité entre langues dominantes et langues dominées, elle peut aussi être source de dialogue, d’échanges, de métissage, y compris dans des situations d’asymétrie, propres notamment à l’espace colonial, où l’interprète, de simple auxiliaire, devient un véritable médiateur culturel. » France Inter
- « Souleymane Bachir Diagne fait ici un travail de mémoire, de philosophe, d’historien et de linguiste. Il crée ou développe une nouvelle manière de concevoir la traduction, à travers des mots aussi lourds de sens que « langue hospitalité », jusqu’à écrire que « la traduction contribue à la tâche de réaliser l’humanité, et même mieux : elle s’y identifie » (p. 166). » L’Obs
- « Dans cet essai d’éthique de la traduction, le philosophe présente l’acte de traduire, source de réciprocité et d’échanges, comme la meilleure réponse à la domination linguistique. Montrant notamment comment les interprètes de l’administration coloniale ont transformé leur rôle en une véritable intermédiation culturelle, il illustre le potentiel décolonisateur de la traduction. » Livres Hebdo
DERNIER OUVRAGE

Essais
Les souvenirs viennent à ma rencontre
Fayard - 2019
Dans ce livre, Edgar Morin, né en 1921, a choisi de réunir tous les souvenirs qui sont remontés à sa mémoire. A 97 ans, celle-ci est intacte et lui permet de dérouler devant nous l’épopée vivante d’un homme qui a traversé les grands événements du XXe siècle. La grande histoire se mêle en permanence à l’histoire d’une vie riche de voyages, de rencontres où l’amitié et l’amour occupent une place centrale.
Ces souvenirs ne sont pas venus selon un ordre chronologique comme le sont habituellement les Mémoires. Ils sont venus à ma rencontre selon l’inspiration, les circonstances. S’interpellant les uns les autres, certains en ont fait émerger d’autres de l’oubli.
Ils témoignent que j’ai pu admirer inconditionnellement des hommes ou femmes qui furent à la fois mes héros et mes amis.
Ils témoignent des dérives et des dégradations, mais aussi des grandeurs et des noblesses que les violents remous de l’Histoire ont entraînées chez tant de proches.
Ils témoignent des illuminations qui m’ont révélé mes vérités ; de mes émotions, de mes ferveurs, de mes douleurs, de mes bonheurs.
Ils témoignent que je suis devenu tout ce que j’ai rencontré.
Ils témoignent que le fils unique, orphelin de mère que j’étais, a trouvé dans sa vie des frères et des sœurs.
Ils témoignent de mes résistances : sous l’Occupation, puis au cours des guerres d’Algérie, de Yougoslavie, du Moyen-Orient, et contre la montée de deux barbaries, l’une venue du fond des âges, de la haine, du mépris, du fanatisme, l’autre froide, voire glacée, du calcul et du profit, toutes deux désormais sans freins.
Ces souvenirs témoignent enfin d’une extrême diversité de curiosités et d’intérêts, mais aussi d’une obsession essentielle, celle qu’exprimait Kant et qui n’a cessé de m’animer : Que puis-je savoir ? Que puis-je croire ? Que puis-je espérer ? Inséparable de la triple question : qu’est-ce que l’homme, la vie, l’univers ?
Cette interrogation, je me suis donné le droit de la poursuivre toute ma vie.
Edgar Morin
— -
Revue de presse :
- « Ce grand penseur souligne l’importance de la pensée dans notre société malade » (Elodie Suigo, 30/01/2020, France Info)
DERNIER OUVRAGE

Edouard Glissant : L’identité généreuse
Flammarion - 2018
Né en 1928, Edouard Glissant est l’un des écrivains et penseurs les plus importants du XXe siècle. Auteur d’une quarantaine d’essais, de romans, de recueils poétiques et de pièces théâtrales, il a donné une mémoire aux peuples issus de l’esclavage et de la Traite. La créolisation du monde lui a inspiré une philosophie de la Relation qui s’adresse à tous. Partant de la transformation de soi, dans la rencontre des autres, il a pensé une nouvelle identité, non plus fondée sur les racines, mais nomade et généreuse. François Noudelmann, qui l’accompagna pendant les douze dernières années de sa vie, a mené l’enquête sur les traces du poète-philosophe en Martinique, en Louisiane, à Cuba, Paris, Tokyo et New York. Dans ce portrait sensible, il suit l’enfance tourmentée de "ti-Edouard", ses relations admiratives et critiques avec Aimé Césaire, son arrivée à Paris dans le renouveau artistique de l’après-guerre, ses succès littéraires, ses amours et ses amitiés. Il analyse ses engagements politiques pour la décolonisation et les indépendances, sa lutte inlassable contre les enfermements identitaires, son activisme culturel à l’Unesco. Il découvre aussi les visages intimes d’Edouard Glissant : les gouffres et les désirs, les nourritures et les vertiges qui ont inspiré ses utopies pour le XXIe siècle.
Bibliographie
- Une magistrale biographie. (Les inrockuptibles)
- Un travail sensible pour éclairer une œuvre complexe et utile. […] Une biographie réussie. (L’Obs)
DERNIER OUVRAGE
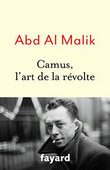
Essais
Camus, l’art de la révolte
- 2016
« Dans une France où une figure internationale, médiatique, cohérente, courageuse, cherchant sans relâche un consensus pertinent et incarnant la grandeur des idéaux intellectuel et humaniste, est totalement absente, voici mon frère, voici notre héros : Albert Camus. »
Abd Al Malik a rencontré Albert Camus dans les pages de ses livres. Et cette rencontre a forgé son devenir d’artiste, de musicien, d écrivain. Entre les premiers textes dans la cité de Strasbourg, les échecs des débuts et les souvenirs d’enfance, il nous montre ici l’importance qu’elle a prise dans son parcours. Le tirant toujours plus haut, toujours plus loin.
Revue de presse :
"Dans Camus, L’art de la révolte Abd al Malik convoque la figure de l’intellectuel engagé. Absurde ? Non ! Camus, son « frère » est, selon lui, « l’homme révolté » dont notre époque a besoin." (Thibault Boixière, Unidivers)
"On ne peut s’empêcher d’entendre les voix de Malik-Camus au fil de la lecture. Mais le livre n’est pas qu’un simple hommage. C’est une ode à la littérature qui bouleverse, qui change une vie, qui fait découvrir le monde." (Audrey Viala, CCAS)
"Albert Camus est l’un des écrivains qui a le plus influencé l’auteur-compositeur-interprète Abd Al Malik dans sa vie et son parcours d’artiste. Ce n’est pas un hasard s’il lui a consacré une pièce il y a quelques temps. L’auteur de La Peste est désormais au coeur de son dernier ouvrage, Camus, l’art de la révolte (Fayard) d’inspiration autobiographique mêlant souvenirs et slams." (Noémie Sudre, Hachette)
DERNIER OUVRAGE

Essais
Sortir du pot au noir - L’humanisme juridique comme boussole
Buchet Chastel - 2019
L’humanité serait-elle entrée dans le « pot au noir », cette zone au milieu des océans où les vents qui soufflent en sens contraires se neutralisent ou se combattent ? Dans un monde pris dans ces tourbillons, entre paralysie et naufrage, où trouver la boussole qui permettrait d’en sortir ?
Pour échapper au désordre, stabiliser l’instable et penser l’imprévisible, il ne suffit pas de placer l’humanité et ses valeurs au centre du monde, comme a tenté de le faire la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. Il faut réguler les vents autour de principes communs et inventer la boussole d’un humanisme élargi à la planète qui guiderait les humains sur les routes imprévisibles du monde.
![]() « Francophonie », un mot exaspérant : tant d’espoirs, tant de désillusions, de malentendus, tant d’occasions manquées ! Mais aussi, tant d’œuvres qui en manifestent la vitalité et font, malgré tout ce qui pèse, de notre histoire commune, l’espace immense d’un dialogue. Cet « espace-monde » : l’utopie concrète d’Étonnants Voyageurs. Dans l’Auditorium, pour ouvrir cette grande thématique, une série de rencontres et de films, qui se prolongeront au fil des trois jours.
« Francophonie », un mot exaspérant : tant d’espoirs, tant de désillusions, de malentendus, tant d’occasions manquées ! Mais aussi, tant d’œuvres qui en manifestent la vitalité et font, malgré tout ce qui pèse, de notre histoire commune, l’espace immense d’un dialogue. Cet « espace-monde » : l’utopie concrète d’Étonnants Voyageurs. Dans l’Auditorium, pour ouvrir cette grande thématique, une série de rencontres et de films, qui se prolongeront au fil des trois jours.