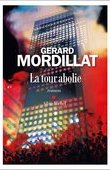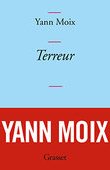DÉMOCRATIE ET LITTÉRATURE
22 mai 2017.
Une histoire française ?
« Une patrie littéraire », nous dit Mona Ozouf de la France, dans un volume rassemblant ses textes sur la littérature (Récits d’une patrie littéraire, Fayard). Même si ça ne va de soi ajoute-elle : la Révolution, qui se voulait le triomphe de la Raison, considérait avec méfiance les écrivains, attentifs aux caprices du cœur, à l’emprise des passions, à la diversité des cultures. De leur opposition-dialogue, qui est aussi de deux visions de la démocratie, s’est faite pourtant, la France. Une conversation entre Mona Ozouf et Michel Le Bris.
- Dimanche 12h15, Grande Passerelle 2
Le retour des années 30 ?
L’histoire ne se répète jamais, voulons-nous croire. Mais par définition nous n’en savons rien et grande, nous le voyons bien, est la capacité d’oubli des générations, toujours présente la tentation du vertige… Crise financière mondiale, montée en réaction des populismes aux États-Unis, en Europe, en Inde, montées aux extrêmes, internationalisation progressive des conflits : en préambule, une rencontre avec Pascal Blanchard et Farid Abdelouahab, historiens, qui publient un album précis, documenté, fascinant et à bien des égards inquiétant Les années 30, et si l’histoire recommençait ? La Martinière). Puis viendront les rejoindre, Renaud Dély, spécialiste du Front National, qui a participé à l’écriture de Les années 30 sont de retour (Flammarion), Johann Chapoutot publie un livre qui fera date, La révolution culturelle nazie (Gallimard) et Gérard Mordillat auteur du Fascisme de Mussolini (Demopolis).
- Dimanche à partir de 10h, Grande Passerelle

- © Hélie (Gallimard) / Sandra Nagel
Récit national, identité : La composition française
Une et indivisible, assurément. Mais plurielle, tout autant, (pour ne pas dire multiculturelle, et pourtant…) : qu’avaient de commun Occitans et Bretons, Provençaux et Picards ? Mona Ozouf, dans Composition française dresse le portrait deux conceptions qui s’opposent, se méfient l’une de l’autre, mais dont le dialogue au final aura fait la France : l’une qui la veut une victoire de la Raison, l’autre qui la dit aussi une diversité culturelle rassemblée. Raphaël Glucksmann qui entend reprendre le « récit national » à ceux qui s’en sont emparés (Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, Allary éditions), Pascal Blanchard historien qui publie Les années trente : et si l’histoire recommençait ? (La Martinière), Patrick Boucheron, à la tête d’un collectif, propose une revigorante Histoire mondiale de la France, reprenant l’idée d’un « récit national » – mais différent…
La force du vertige
Comment penser la Terreur ? Penser le nouveau monde qu’elle inaugure ? L’avalanche des analyses, « pour tenter de déchiffrer l’indéchiffrable et essayer de défricher l’indéchiffrable » démontre que quelque chose, toujours, leur échappe. Yann Moix, au jour le jour, a noté ses réflexions, tenté de capter dans cette forme brisée, quelque chose de la stupeur qui s’est emparé de nous. De la puissance aussi du nihilisme, de ce vertige qui aboutit à l’acte terroriste (Terreur, Grasset). Raphaël Glucksmann (Génération gueule de bois, Notre France – dire et aimer ce que nous sommes, Allary éditions), de livre en livre, tente de reconstruire un discours de résistance. Et si l’on reparlait de valeurs – autrement dit de transcendance ?
Les enjeux de la culture
La culture comme rempart contre la barbarie ? Pas si simple : toutes les cultures ne se valent pas. La preuve : il y eut une culture nazie, des artistes nazis, des philosophes nazis, dont un qui embarrasse bien le monde intellectuel. Non : le combat est à l’intérieur de la culture. Pour une certaine idée de l’être humain… Une rencontre en ouverture de la matinée « littérature-monde », entre Jean-Michel Le Boulanger, Christiane Taubira, Johann Chapouteau et Patrick Chamoiseau.
Femmes, culture, démocratie
Table ronde proposée par les éditions des Femmes-Antoinette Fouque
Lier la littérature, ou l’écriture, et la démocratisation est constitutif des éditions des femmes-Antoinette Fouque depuis leur création en 1973. « Si l’on considère que les peuples sans écriture n’ont pas d’histoire, il fallait passer par l’écriture pour entrer dans l’histoire », écrivait leur fondatrice en 2013. Cette aventure sera abordée à partir des parutions récentes : Pour mémoire (Argentine, 1976-1983) de Susana Romano Sued, qui porte témoignage de la torture, présenté par Anne-Charlotte Chasset, sa co-traductrice et par Marie-Laure Stirnemann, co-fondatrice de l’association Hijos-Paris ; Rébellion du Mouvement FEMEN présenté par d’eux d’entre elles, Pauline Hillier, Fleur d’Aboville ; La Révolte d’Eve, chroniques de Marcelle Tinayre, écrivaine et militante féministe (XIXe-XXe siècle) réunies et présentées par Alain Quella-Villéger ; Accueillir l’autre : l’hospitalité charnelle, présenté par François Guery, philosophe, co-auteur, un livre de la collection « Penser avec Antoinette Fouque », qui sera présentée par une des éditrices, Elisabeth Nicoli.
- Lundi 14h, Rotonde Surcouf
DERNIER OUVRAGE

Essais
Pour l’amour des livres
Grasset - 2019
« Nous naissons, nous grandissons, le plus souvent sans même en prendre la mesure, dans le bruissement des milliers de récits, de romans, de poèmes, qui nous ont précédés. Sans eux, sans leur musique en nous pour nous guider, nous resterions tels des enfants perdus dans les forêts obscures. N’étaient-ils pas déjà là qui nous attendaient, jalons laissés par d’autres en chemin, dessinant peu à peu un visage à l’inconnu du monde, jusqu’à le rendre habitable ? Ils nous sont, si l’on y réfléchit, notre première et notre véritable demeure. Notre miroir, aussi. Car dans le foisonnement de ces histoires, il en est une, à nous seuls destinée, de cela, nous serions prêt à en jurer dans l’instant où nous nous y sommes reconnus – et c’était comme si, par privilège, s’ouvrait alors la porte des merveilles.
Pour moi, ce fut la Guerre du feu, « roman des âges farouches » aujourd’hui quelque peu oublié. En récompense de mon examen réussi d’entrée en sixième ma mère m’avait promis un livre. Que nous étions allés choisir solennellement à Morlaix. Pourquoi celui-là ? La couverture en était plutôt laide, qui montrait un homme aux traits simiesques fuyant, une torche à la main. Mais dès la première page tournée… Je fus comme foudroyé. Un monde s’ouvrait devant moi…
Mon enfance fut pauvre et solitaire entre deux hameaux du Finistère, même si ma mère sut faire de notre maison sans eau ni électricité un paradis, à force de tendresse et de travail. J’y ai découvert la puissance de libération des livres, par la grâce d’une rencontre miraculeuse avec un instituteur, engagé, sensible, qui m’ouvrit sans retenue sa bibliothèque.
J’ai voulu ce livre comme un acte de remerciement. Pour dire simplement ce que je dois au livre. Ce que, tous, nous devons au livre. Plus nécessaire que jamais, face au brouhaha du monde, au temps chaque jour un peu plus refusé, à l’oubli de soi, et des autres. Pour le plus précieux des messages, dans le temps silencieux de la lecture : qu’il est en chacun de nous un royaume, une dimension d’éternité, qui nous fait humains et libres. »
- “Du grenier breton où le gamin plonge tête la première dans La Guerre du feu, jusqu’à la découverte en bibliothèque du Dernier des Mohicans et de Moby Dick, flibustiers et explorateurs, pionniers et cannibales sont réunis ici pour rappeler la puissance de la lecture sur un enfant solitaire.” Télérama
- “Ce nouvel opus est à la fois une autobiographie et un essai. Une ode à l’écriture et aux écrivains. Michel Le Bris fait de la lecture une nécessité, une urgence pour se construire soi-même. La littérature est aussi un engagement et une bataille pour la culture, essentielle à la démocratie.” France Inter
- "Pour l’amour des livres participe de belle manière à cet hommage choral que les écrivains ont rendu au fil du temps afin de s’acquitter de leur dette envers une littérature qui leur a tant apporté." Zone Critique
DERNIER OUVRAGE
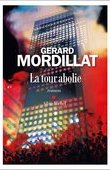
Romans
La Tour abolie
Albin Michel - 2017
« Quand les pauvres n’auront plus rien à manger, ils mangeront les riches. »
La tour Magister : trente-huit étages au cœur du quartier de la Défense. Au sommet, l’état-major, gouverné par la logique du profit. Dans les sous-sols et les parkings, une population de misérables rendus fous par l’exclusion. Deux mondes qui s’ignorent, jusqu’au jour où les damnés décident de transgresser l’ordre social en gravissant les marches du paradis.
Avec la verve batailleuse qui a fait le succès de La Brigade du rire, Gérard Mordillat, l’auteur de Vive la sociale ! et de Les Vivants et les morts, livre une fable prodigieuse sur la société capitaliste et la révolte de ceux qu’elle exclut.
Revue de presse
- "Mordillat a écrit le roman de la révolte, de ceux qui n’en sont même pas au « gagner plus ». Parfois le trait est gros, mais un vrai souffle l’emporte. Sa colère gronde et vise juste." (La Vie)
- "La fable est à la fois sombre et lumineuse. Et Gérard Mordillat décidément l’un des peintres les plus inventifs des contradictions de ce temps." (Jean-Claude Lebrun, L’Humanité)
DERNIER OUVRAGE

Romans
Le vent du nord dans les fougères glacées
Seuil - 2022
« Boulianno Nérélé Isiklaire était espécial. Il savait des choses sur le profond du conte, sur la Parole qui demande majuscule, sur la lutte contre la mortalité… Il avait développé une connaissance de tout cela dans le secret de son esprit. »
Le dernier « maître de la Parole » qui, comme les bambous a sept vies et ne fleurit qu’une fois, va s’enfermer dans le silence. Il s’est réfugié dans les hauteurs de l’île, plus haut encore que les mornes où se sont développées les pratiques des veillées. Avant que son retrait ne soit définitif, un groupe espérant qu’il formera l’un des leurs, « le tambour Populo », et, de son côté, une toute jeune fille étrange et solitaire, surnommée « l’anecdote », partent sur ses traces pour qu’il choisisse l’héritier et lui donne en legs sa dernière leçon et le secret de sa poésie. Mais les deux jeunes gens s’associent. Ils vont retrouver, au prix d’innombrables exploits, trois cases successives…
Patrick Chamoiseau renoue donc, au bout de quinze ans, avec sa grande veine narrative riche en personnages inoubliables.
DERNIER OUVRAGE

Beaux livres
Les années 50, et si la Guerre froide recommençait ?
La Martinière - 2018
Avec Farid Abdelouahab, Pierre Haski et Pascal Blanchard
La guerre froide, la conquête de l’espace, la peur du nucléaire, la fin des colonies, les États-Unis triomphantes, le Cuba de Castro, de Gaulle au pouvoir, la guerre d’Algérie… Cet ouvrage, véritable tour du monde en images, dresse un panorama complet des années 50 en revenant sur les événements politiques, sociaux et culturels majeurs de la décennie. Un rappel des temps forts construit autour d’une comparaison inédite entre les années 50 et aujourd’hui. Et si l’histoire se répétait ? Et si, en Corée, une nouvelle Guerre froide commençait ? Le mur anti-migrants de Donald Trump comme un écho au programme d’expulsion des Mexicains de Dwight D. Eisenhower, la domination militaire russe en héritage de Nikita Khrouchtchev à Vladimir Poutine, la menace nucléaire qui se perpétue… Les enjeux passés n’ont jamais été aussi présents. Illustré de plus de 225 documents d’archives, cet essai nous invite à pénétrer autrement les fifties, comme le miroir de la société contemporaine.
DERNIER OUVRAGE

Essais
Olympisme, une histoire du monde. Des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
La Martinière - 2024
Cet ouvrage de référence sur les 30 Jeux Olympiques d’été, de 1896 à 2024, rend hommage aux athlètes à travers plus de mille images exceptionnelles. Une soixantaine de spécialistes, français et internationaux, offrent en parallèle un panorama complet de chacune des olympiades et proposent une « histoire-monde » résolument transnationale de l’olympisme moderne. Au cours de ces 130 années de Jeux Olympiques se dessinent les grandes mutations de nos sociétés et leurs enjeux politiques, économiques et culturels.
Ce catalogue de l’exposition présentée au Palais de la Porte Dorée d’avril à septembre 2024 retrace la construction des États-nations, l’émergence de la culture de masse, l’entre-deux-guerres marqué par l’opposition entre totalitarisme et démocratie, la Guerre froide, les vagues de décolonisation ou encore les revendications des minorités et des pays émergents. Il évoque aussi la mondialisation économique et le gigantisme des Jeux Olympiques d’aujourd’hui, la reconnaissance du paralympisme, sans oublier d’aborder les questions éthiques et sociétales qui traversent le mouvement olympique en ce XXIème siècle.
DERNIER OUVRAGE
Essais
Lettre à Thibaut Pinot
Goater - 2024
Le mois d’octobre 2023 marque la fin de carrière du cycliste Thibaut Pinot. Aimé pour ses victoires autant que pour ses échecs, il a marqué les esprits de nombreux supporters. Jean-Michel Le Boulanger est l’un d’entre eux. Une lettre entre ode au coureur, traversée intime de la Bretagne et récit autour du cyclisme. « Vous êtes un drôle de coureur, Thibaut Pinot. Vous grimacez quand tant de vos concurrents paraissent impavides, impassibles. Vous attaquez et attaquez encore quand tant de coureurs semblent mesurer leurs forces. Vous êtes malade quand il ne faut pas l’être. Vous êtes victime de défaillances quand d’autres sont toujours fidèles à leur niveau, dans une régularité de métronome. Vous gagnez des étapes très prestigieuses et perdez du terrain à des moments plus anodins. Oui, vous êtes un drôle de coureur et être supporter de Thibaut Pinot est un exercice difficile. Ce qui est sûr, et c’est pourquoi on vous aime, c’est qu’avec vous l’eau n’est jamais tiède ni la course prévisible. »
DERNIER OUVRAGE

Essais
Pour rendre la vie plus légère
Stock - 2020
"Pourquoi la littérature ? Parce que la littérature nous pourvoit de dons que nous n’avons pas. Elle nous pourvoit immédiatement de l’ubiquité. Grâce à la littérature, nous vivons dans des pays, des villes où nous n’avons jamais posé le pied. Grâce à la littérature, nous pouvons reculer vers des époques révolues. Il y a une sorte d’immense liberté que donne la pratique des livres, et que nous n’avons pas. La démultiplication de l’existence dans la littérature est une chance précieuse". Ce volume contient les principales émissions faites par Mona Ozouf à "Répliques" , sous la direction d’Alain Finkielkraut : sur les femmes et la singularité de leur écriture ; sur les livres comme "patrie" ; sur la galanterie française ; sur la civilité ; sur le Panthéon ; sur la Révolution française ; sur Henry James ; sur George Eliot. Les partenaires avec lesquels elle dialogue ici sont Diane de Margerie, Claude Habib, Pierre Manent, Geneviève Brisac, Philippe Belaval, Philippe Raynaud, Patrice Gueniffey. C’est tout un parcours intellectuel qui est ici dessiné, depuis ses travaux fondateurs sur la Révolution française jusqu’à ce qu’elle appelle ses "échappées belles" en littérature. Mona Ozouf est une "figure aussi discrète que rayonnante de la scène intellectuelle française", comme l’écrit Jean Birnbaum dans Le Monde. A bonne distance de tous les enrôlements et de toutes les assignations identitaires, elle maintient inébranlable le souci d’une ligne originale.
Entretiens avec Alain Finkielkraut, dans l’émission Répliques
— -
Revue de presse :
- « La restitution d’entretiens radiophoniques est un pari risqué, mais il fonctionne excellemment tant l’art de la conversation et la maîtrise de la langue sont ici à leur sommet » (Eugénie Bastié, Le Figaro)
DERNIER OUVRAGE

Récit
La vraie Marine Le Pen
Plon - 2017
Qui est vraiment Marine Le Pen ? Qui est cette femme qui a tout hérité de son père – le parti, les idées, la violence –, et qui n’a pas hésité à l’éliminer sur l’autel de son ascension ?
Assoiffée de pouvoir et de reconnaissance, l’héritière s’est lancée à la conquête du pouvoir suprême : l’Élysée, qu’elle espère décrocher en mai 2017. Pour ce faire, Marine Le Pen a changé l’image du Front national, mais en a-t-elle vraiment modifié la nature ? Façonnée par les secousses qui ont fracturé un clan familial hors norme, étudiante fêtarde élevée dans le luxe, bourgeoise deux fois divorcée, Marine Le Pen est en réalité une " bobo " plutôt décoincée sur les questions sociétales. Mais la " bobo " reste une " facho ". Fidèle aux combats de l’extrême droite xénophobe et antirépublicaine, la présidente du FN est arc-boutée sur la défense d’une identité française fantasmée, hostile aux immigrés en général et aux musulmans en particulier. Attisant les souffrances nées de la crise, elle a ancré son parti sur une ligne " ni droite ni gauche " qui renoue avec la tradition anticapitaliste de l’extrême droite française de la fin du xixe siècle. Le marinisme, ce nouvel âge du lepénisme aux contours lissés, n’a jamais semblé aussi près d’offrir les rênes de la République à ceux qui en demeurent ses farouches ennemis. Fruit d’une enquête menée au coeur du FN, ce livre lève le voile sur la vraie nature de Marine Le Pen. Et sur son véritable dessein.
Revue de presse
- "Le livre de Renaud Dély dispose d’un atout considérable : il est utile en ces temps de confusion." (Maurice Szafran, Le Magazine Littéraire)
DERNIER OUVRAGE

Essais
Les Enfants du vide. Sortons de l’individualisme
Allary Éditions - 2018
« Nous sommes libres, sommes-nous pour autant heureux ? La sourde inquiétude qui nous tenaille vient de l’absence d’horizon collectif, de la crise des récits et des structures qui inscrivaient hier encore l’individu dans un tout. Nos parents ont déconstruits ces récits qui étaient des mythes aliénants, et ils ont eu raison. Mais nous ne pouvons nous contenter du rien qui prit leur place.
Si nos aînés sont arrivés au monde dans une société saturée de sens, nous sommes nés dans le vide. Leur mission était de briser des chaînes, la nôtre sera de retisser des liens.
La démocratie repose sur les droits de chacun, mais pas seulement. La tâche de notre génération sera de nous préoccuper de ce "pas seulement" qui fut trop longtemps délaissé : le droit du tout sur chacun. Car si nous ne le faisons pas, les forces les plus autoritaires le feront à notre place. » R.G.
Dans la lignée de Génération gueule de bois, Raphaël Glucksmann interroge le manque d’horizon collectif des générations élevées dans des sociétés individualistes.
- « Un style vif, fondé sur une culture politique sûre. » Libération
- « Ce passionnant essai dresse un constat cinglant de "la société de solitude" » Le Monde
DERNIER OUVRAGE

Essais
Le temps qui reste
Seuil - 2023
On nous l’annonce comme imminente et inéluctable : une catastrophe lente à venir. On nous l’annonce depuis si longtemps. Mais est-ce pour nous alerter ou pour nous habituer ? Il est grand temps d’en décider. Car on peut craindre, ou espérer, un événement qui, lorsqu’il advient n’est pas le surgissement de l’inconnu mais la poursuite de ce que l’on connaissait très bien et qu’on n’a pas su éviter. On se rend compte alors, mais trop tard, qu’à force de l’attendre, on n’a pas compris qu’il était déjà advenu.
- « « Le temps impose parfois à l’historien d’entrer dans la mêlée ». La conjonction des crises climatique et politique, adossée à la montée de l’extrême droite et à sa prise de contrôle médiatique, fait peser un risque sur nos sociétés, et nous somme d’élaborer un « contre-récit », prévient l’historien. » Le Monde
- « Dans ce livre court, de 84 pages, l’auteur se penche sur l’importance de la place de l’historien dans le paysage médiatique. Il invite ici le lecteur à dépasser le sentiment d’impuissance qui nous paralyse lorsque l’on pense à tout ce qui menace l’humanité et à saisir le présent à bras-le-corps. Il mesure l’importance et la peur "du temps qui reste". » France 5
- « La crise politique ou la catastrophe climatique, en cours ou à venir, semblent renvoyer à une accélération du temps. Un événement n’est pourtant jamais le surgissement de l’inconnu mais la poursuite du connu, dit Patrick Boucheron. Face aux urgences et à l’impression d’un terrible compte-à-rebours, le regard de l’historien pour se saisir du « temps qui reste » demeure particulièrement précieux. » Les Rendez-vous de l’histoire
- « Comment ne pas céder à l’air du temps catastrophiste ? Celui qui assume l’incertitude de son savoir invite à ne renoncer à rien dans une réflexion stimulante sur le présent, et sur ce que peut l’histoire pour agir sur lui. » Les Inrocks
- « L’attaque d’Arras, qui a coûté la vie à Dominique Bernard, semble répéter l’attentat contre Samuel Paty, trois ans plus tôt. L’historien Patrick Boucheron rend hommage à ces professeurs engagés dans l’éveil des consciences et rappelle pourquoi l’histoire est « un art d’émancipation ». » La Croix
DERNIER OUVRAGE
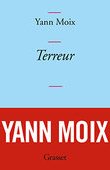
Essais
Terreur
Grasset - 2017
« Ce livre, écrit au jour le jour pendant et après les attentats contre Charlie Hebdo et à l’Hypercacher, ne sort que deux ans après les événements : il fallait respecter le temps du deuil ; et me donner la faculté de suspendre celui de la réflexion. "Penser" les attentats est une gageure, parfois même un oxymore : le risque est soit de donner trop de sens à ce qui n’en a pas, soit de rater les étapes d’un processus plus complexe qu’il n’y paraît. Penser les attentats, c’est possiblement se tromper. Ce livre est un cheminement, une progression, une interrogation, un questionnement sur la radicalité, la radicalisation, la jeunesse, l’islamisation, la violence, le nihilisme. Autant de termes qu’on ressasse à longueur de journées sans jamais s’arrêter pour les creuser, les approfondir jusqu’à la nausée. Ce petit essai est obsessionnel : revenir à l’infini sur les actes, les causes, les effets, les acteurs, les conséquences, sans jamais se raturer, au risque même, çà et là, de se contredire. Les frères Kouachi, Amédy Coulibaly sont les tristes protagonistes d’un événement originel, matrice de tous les attentats qui suivirent : les notes et scolies rédigées à chaud et publiées maintenant, doivent se plaquer sur tous les attentats qui suivirent, et qui sortent tout droit, peu ou prou, de janvier 2015.Car ce qui me frappe à la relecture d’un texte rédigé il y a deux ans, c’est à quel point ce qui y était prévu est déjà advenu ou encore, hélas, à advenir . Je n’ai donc rien censuré des passages prophétiques qui me donnent aujourd’hui le sentiment d’une réflexion rattrapée par le réel, au prétexte qu’ils pourraient être lus comme ayant été rédigés rétroactivement à partir du réel : on ne s’excuse pas d’avoir eu raison trop tôt. "Nous sommes en guerre" a dit le président de la République. Les écrivains ont toujours voulu dire la guerre. Je n’échappe ni à la règle, ni à la tradition. »
Revue de presse
- "C’est un livre vraiment passionnant. Il fonctionne par intuition, par fulgurance." ( Jean-Claude Raspiengeas, France Inter)
- "Terreur, qui convoque Maxime Du Camp, Philippe Ivernel, Nietzsche, André Suarès, Machiavel ou Sénèque, explique pourquoi « nous en avons pour un siècle » d’actes terroristes comme à Paris, à Nice ou à Berlin." (L’Hebdo)
DERNIER OUVRAGE

Essais
La révolution culturelle nazie
Gallimard - 2017
Pour les nazis, la "culture" était à l’origine la simple transcription de la nature : on révérait les arbres et les cours d’eau, on s’accouplait, se nourrissait et se battait comme tous les autres animaux, on défendait sa horde et elle seule. La dénaturation est intervenue quand les Sémites se sont installés en Grèce, quand l’évangélisation a introduit le judéo-christianisme, puis quand la Révolution française a parachevé ces constructions idéologiques absurdes (égalité, compassion, abstraction du droit...). Pour sauver la race nordique-germanique, il fallait opérer une "révolution culturelle", retrouver le mode d’être des Anciens et faire à nouveau coïncider culture et nature. C’est en refondant ainsi le droit et la morale que l’homme germanique a cru pouvoir agir conformément à ce que commandait sa survie. Grâce à la réécriture du droit et de la morale, il devenait légal et moral de frapper et de tuer. Avec ce recueil d’études, Johann Chapoutot parachève et relie le projet de deux de ses livres précédents, Le National-socialisme et l’Antiquité (2008) et La Loi du sang : penser et agir en nazi (2014). En approfondissant des points particuliers, comme la lecture du stoïcisme et de Platon sous le IIIe Reich, l’usage de Kant et de son impératif catégorique ou la réception en Allemagne du droit romain, il montre comment s’est opérée la réécriture de l’histoire de l’Occident et par quels canaux de telles idées sont parvenues aux acteurs des crimes nazis.
Revue de presse
- "L’historien Johann Chapoutot publie La révolution culturelle nazie. Livre qui s’inscrit dans une manière de penser le nazisme non pas comme phénomène accidentel ou « fonctionnel » mais comme lieu d’adhésion à son idéologie. Une croyance. Le fil rouge de ce recueil de onze études ?" (Le Causeur)
- "[…] cet ouvrage est un assemblage d’articles remaniés portant sur l’histoire des idées en Allemagne, offrant une juxtaposition d’analyses de la pensée nazie comme autant de strates archéologiques. Ce travail de composition aborde résolument ce que Mosse nommait « l’oeil du nazisme », en révélant l’importance de la philosophie platonicienne pour des historiens, des philologues et des juristes nazis comme Fritz Schaehermeyr, Hans Bogner, Roland Freisler, ou Hans Günther, maître d’une anthropologie raciale alors réputée, ou de philosophes comme, Erns Krieck ou Kurt Hildebrandt qui tous voient dans l’oeuvre de Platon une démonstration de l’idéal d’un corps social guerrier." (Le Temps)